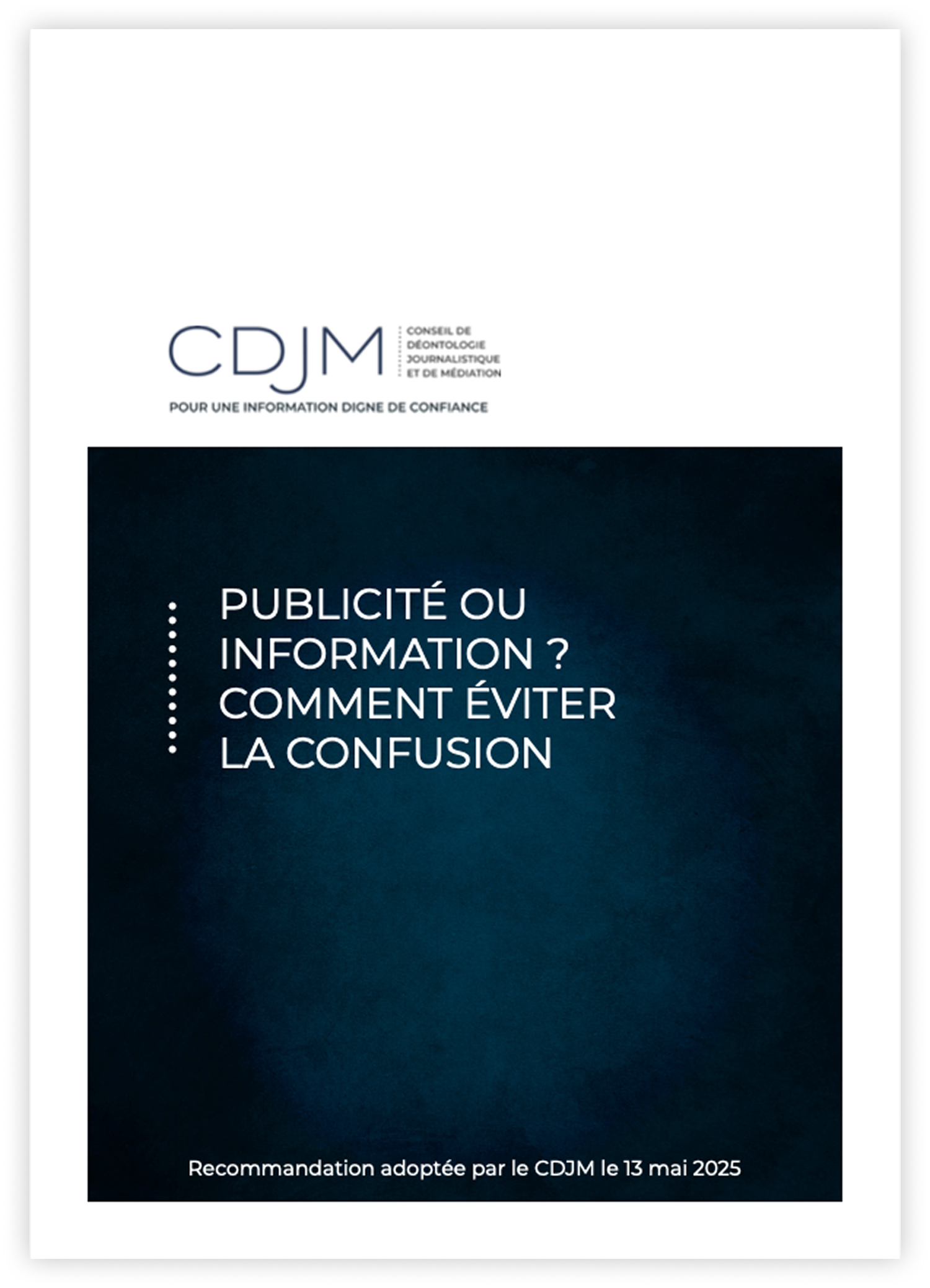Cette recommandation a été adoptée par le CDJM le 13 mai 2025.
Avant-propos
Depuis 2020, le CDJM est régulièrement saisi par le public pour des questions de confusion entre publicité et information, ce qui constitue un manquement déontologique. Que ce soit en ligne, dans les journaux ou à la télévision, les utilisateurs de médias se sentent parfois perdus et peinent à distinguer ce qui relève de l’un ou de l’autre. Confronté à des contenus publicitaires qui empruntent la forme d’actes journalistiques ou à des actes journalistiques qui font la promotion d’un produit, d’un service ou d’une entreprise, le public peut se sentir trompé et accorder moins de crédibilité et de confiance aux médias.
Ce genre de publicité n’est pas nouveau, mais il a connu ces dernières années un grand développement dans les médias, notamment en ligne. On les appelle publireportage ou publicité rédactionnelle, mais les termes native advertising ou brand content sont aussi largement utilisés (lire les précisions de vocabulaire en annexe).
De manière générale, ces termes désignent toute publicité qui emprunte, par sa forme et par son contenu, les codes du média dans lequel elle s’insère. En ligne, elles sont souvent signalées par la mention « sponsorisé » et dans la presse écrite par les mentions « publicité » ou « communiqué ». Cependant, pour le public, il n’est pas toujours facile de les distinguer du reste.
Le CDJM ne se prononce que sur les questions relatives à la déontologie journalistique et seulement sur des actes journalistiques publiés ou diffusés, quels que soient leurs supports. Il n’est pas compétent pour se prononcer sur des actes publicitaires – quand bien même ils ressembleraient, par leur forme, à des actes journalistiques. Mais il est compétent pour se prononcer sur tout acte journalistique qui, en induisant une confusion entre information et publicité, contrevient aux chartes déontologiques auxquelles le Conseil se réfère.
Afin de permettre au public et aux professionnels d’y voir plus clair sur ce sujet, cette recommandation rappelle comment identifier la publicité dans les médias et propose une série de bonnes pratiques dans le traitement des produits ou événements commerciaux dans une production journalistique. Ces principes s’appliquent quel que soit le support de diffusion de l’information, ce qui inclut les réseaux sociaux et autres plateformes numériques.
Les règles en vigueur
Une pratique encadrée par la loi…
En droit français, la pratique des publicités rédactionnelles dans les médias est autorisée, à la condition qu’elles soient rendues identifiables par le consommateur.
Ainsi le code de la consommation, dont l’objectif est de protéger le consommateur notamment en prohibant les pratiques trompeuses, indique-t-il dans son article L121-4 11 : « Sont réputées trompeuses, les pratiques qui ont pour objet […] d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur. »
En ce qui concerne la presse écrite, la loi du 1er août 1986 réformant le régime juridique de la presse indique dans son article 10 : « Toute publicité à présentation rédactionnelle doit être précédée de la mention “publicité” ou “communiqué”. »
S’agissant du numérique, la loi « Confiance dans l’économie numérique » de 2004 prévoit de son côté, à son article 20 : « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »
… et par les textes déontologiques
Les textes déontologiques sur lesquels se fonde le CDJM rappellent qu’il existe une frontière entre le métier de journaliste et celui de communicant ou publicitaire. Cela implique une indépendance du journaliste à l’égard des annonceurs.
Ainsi, la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (SNJ, 1918-1938-2011) prévoit que « le journaliste doit refuser et combattre, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication. » Ce que rappelle la Déclaration des droits et des devoirs des journalistes (Munich, 1971, devoir no 9) : « Le journaliste ne doit jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste, n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. » Même règle dans la Charte d’éthique mondiale des journalistes (FIJ, 2019, article 13) : « Le journaliste évitera toute confusion entre son activité et celle de publicitaire ou de propagandiste. »
De son côté, la convention collective nationale des journalistes indique dans son article 5 :
« a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d’autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l’entreprise de presse à laquelle il collabore.
« En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l’éloge d’un produit, d’une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.
« b) Un employeur ne peut exiger d’un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu’elle résulte de l’article 10 de la loi du 1er août 1986.
« c) Le refus par un journaliste d’exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l’objet d’un accord particulier. »
Une autorité d’autorégulation du secteur, l’ARPP
L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) assure l’autorégulation de la publicité professionnelle en établissant son code de déontologie et en assurant le contrôle de ce dernier.
Sur la question de l’identification des publicités, l’ARPP a publié une recommandation intitulée « Identification de la publicité et des communications commerciales » qui tente de clarifier ce qui est entendu par le terme « clairement identifiable » utilisé dans les textes législatifs (lire ci-dessus). Le code de la Chambre de commerce internationale (ICC) encadre également cette pratique et dispose, dans son article 7 :
« Les communications commerciales doivent être clairement identifiables en tant que telles, quelle que soit leur forme et quel que soit le support utilisé. Lorsqu’une publicité, y compris une publicité dite “native”, est diffusée dans un média comportant des informations ou du contenu rédactionnel, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire soit évident et, le cas échéant, doit être marquée comme telle.
« La finalité commerciale de la communication doit être apparente et la communication ne doit pas occulter sa finalité commerciale réelle. Ainsi, une communication favorisant la vente d’un produit ne doit pas être indûment présentée comme, par exemple, une étude de marché, une enquête auprès des consommateurs, un contenu généré par un utilisateur, un blog privé, une publication privée sur les médias sociaux ou une critique indépendante. »
L’article 8 du même texte revient sur l’identification du commanditaire : « L’identité de l’annonceur doit être transparente. Les communications commerciales doivent, le cas échéant, inclure les coordonnées afin de permettre au consommateur de contacter sans difficulté l’annonceur. »
Lorsque le public estime qu’une publicité présente dans un média ne respecte pas ces critères, il peut saisir le Jury de déontologie publicitaire (JDP). Il est possible de présenter gratuitement une plainte contre une publicité. Elle sera traitée par le Jury, qui y apportera une réponse. La procédure est décrite sur le site de l’instance.
Au regard des différents codes et chartes déontologiques, le CDJM souhaite rappeler quelques règles essentielles.
Ce que recommande le CDJM
Identifier un message commercial
Il est nécessaire que les journalistes et les médias mettent tout en œuvre pour éviter la confusion entre contenu publicitaire et contenu journalistique. Sur la forme, l’identification de la publicité se doit d’être la plus explicite et la plus intelligible possible.
La mention indiquant qu’il ne s’agit pas d’une production journalistique doit figurer à proximité du visuel concernant la marque. Une telle précaution s’impose quelle que soit la nature exacte de l’opération réalisée par le média concerné (campagne rémunérée ou simple partenariat sans compensation financière).
Quel que soit le support, il est essentiel de bien identifier ce qui relève de l’information, donc de l’indépendance éditoriale, clé de voûte de la crédibilité, et les espaces de communication et de contenus publicitaires. Il importe d’éviter des termes ambigus comme « communiqué » ou « supplément », qui ne sont pas suffisamment explicites (lire encadré).
Le choix des mots
Les recherches en psychologie sociale recommandent d’employer des termes suffisamment explicites, comme « publicité ». La mention « payée » est assimilée par 83 % à 89 % des personnes interrogées à un contenu payé, quand la mention « sponsorisée » ne permet l’identification que par 76 % à 79 % d’entre eux, selon une étude publiée en 2017 dans le Yale Journal of Law & Technology.
Les indications explicites (comme « publicité » ou « contenu payé ») aident sensiblement les consommateurs à reconnaître un contenu payant, comme le montre une autre étude publiée en 2018 dans le Journal of Interactive Advertising.
Parler d’un produit commercial dans un contenu journalistique
- Citer un produit. Le journaliste doit éviter de reprendre à son compte les affirmations laudatives présentes dans la communication de l’entreprise. Ses critiques négatives ou positives doivent s’appuyer sur des éléments concrets. Il se doit d’ajouter, s’il le peut, des éléments de contexte sur les produits concurrents, surtout s’il fait référence à des éléments de prix. Ces précautions sont encore plus prégnantes quand une entreprise où une personne interrogée a des liens capitalistiques avec le média qui publie ou diffuse l’acte journalistique concerné.
- Lire une publicité. Lire ou dire une publicité est un acte de publicitaire. Les médias privés doivent confier cette tâche dans les émissions d’information à une tierce personne, pour bien distinguer ce qui est information de ce qui est annonce commerciale. Cela s’applique bien évidemment aux productions journalistiques diffusées en ligne.
- Éviter les conflits d’intérêts. Un journaliste ne doit pas traiter de sujets dans lesquels il a directement ou indirectement un intérêt personnel ou commercial. Dans le cas où il se trouverait en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts, le journaliste doit le signaler à son rédacteur en chef, voire se déporter. S’il ne se déporte pas, il doit mentionner ses liens d’intérêts.
Il incombe au rédacteur en chef de garantir l’indépendance éditoriale et de veiller à ce que les activités commerciales n’empiètent jamais sur la liberté éditoriale de l’équipe. - Traiter un communiqué de presse. Il est important de conserver suffisamment de distances à l’égard des éléments de communication diffusées par les marques. Par exemple, ne pas citer ou reprendre le communiqué de presse totalement ou partiellement sans l’identifier clairement comme tel.
- Couvrir un événement parrainé. Les journalistes rendent compte – ou choisissent de ne pas rendre compte – des événements parrainés par les médias pour lesquels ils travaillent en toute indépendance et avec la même déontologie que pour tout autre événement. Pour le CDJM, cela implique :
– qu’il n’y ait pas d’intervention du partenaire sur la couverture de l’événement (choix des angles, des personnes interviewées, etc.)
– qu’il n’y ait pas de validation par le partenaire du contenu journalistique publié ou diffusé.
– que la liberté éditoriale du journaliste qui couvre l’évènement ou y participe soit respectée, par exemple possibilité d’émettre des critiques, liberté dans le choix des illustrations. - Cadeaux et invitations. Une autre confusion peut avoir lieu dans l’esprit du public quand les journalistes profitent d’invitations ou que des objets ou des services sont mis gratuitement à leur disposition pour faire leur travail. Le CDJM a publié en janvier 2023 une recommandation à ce sujet. Cette dernière rappelle les règles de rigueur, d’exactitude, d’impartialité, d’équité et d’intégrité, présidant à la profession de journaliste et, qu’à ce titre, l’acceptation des cadeaux est en contradiction avec ces règles. Ce document référence par mots-clés les bonnes pratiques au sein des rédactions afin d’éviter les pièges.
Lexique
Sans objectif prescriptif, cette annexe ne vise pas l’exhaustivité, mais veut expliciter quelques expressions que recouvrent le terme « communication publicitaire » utilisé dans le document, en donnant des exemples de définitions des différents termes utilisés.
Publicité rédactionnelle, publi-reportage, publi-rédactionnel. « Texte publicitaire rédigé pour le compte d’un annonceur sous une forme rédactionnelle et dans un style de présentation comparable à ceux de la publication dans laquelle il est inséré. Ce texte peut être publié dans une section spéciale, dans un supplément ou dans les pages ordinaires de la publication. Il doit être signalé comme étant de la publicité. » (Balle, 2006).
Publicité native, native advertising, publicité caméléon ou mimétique. La publicité native est une forme de publicité en ligne (sur tous les supports numériques) qui a pour but d’attirer l’attention du consommateur en fournissant du contenu par lequel on entre dans l’univers de la marque plutôt que dans la présentation directe de produits. Ce format de publicité s’adapte donc à la forme et aux spécificités du média. Elle est appelée native parce qu’elle s’inscrit au cœur du système.
Brand content. Désigne des contenus éditoriaux produits par une marque ou des entreprises spécialisées, qui peuvent être diffusés sur Internet, des supports papier ou encore dans des médias plus traditionnels comme la radio ou la télévision. Ce contenu peut prendre différentes formes, telles que des vidéos, des podcasts, des articles… L’objectif est de créer un univers immédiatement identifiable : le brand content emprunte le style éditorial, visuel, ou audiovisuel du support qui le présente. Certaines publicités natives diffusées par les médias sont du brand content.
Parrainage, sponsoring. En droit, selon l’article 17 du décret n°92-279, « constitue un parrainage toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée, n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement d’émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ».